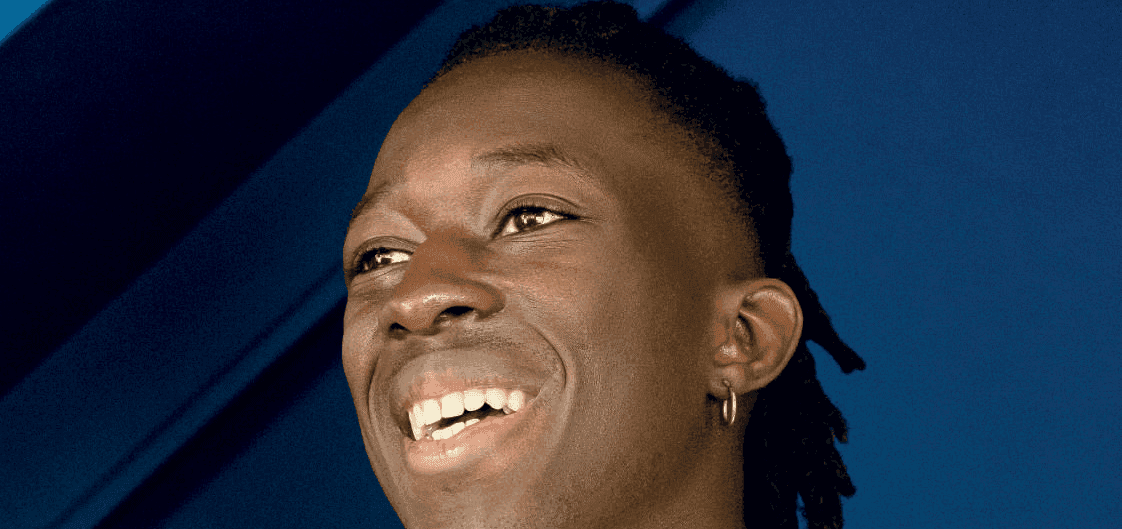Magazine Rungis Actualités
Chaque mois, retrouvez le dossier thématique extrait du Rungis Actualité, le magazine officiel du Marché International de Rungis.
N° 777
La générosité bavaroise
La générosité bavaroise
Octobre 2021
N° 776
Agriculture, la diversité francilienne
Agriculture, la diversité francilienne
Septembre 2021
N° 775
L'épicerie opère son grand retour
L'épicerie opère son grand retour
Juillet-Août 2021
N° 774
Annick Girardin : "Nous souhaitons une pêche durable"
Annick Girardin : "Nous souhaitons une pêche durable"
Juin 2021
N° 773
Mory Sacko, l'étoile montante de la gastronomie
Mory Sacko, l'étoile montante de la gastronomie
Mai 2021
N° 772
Made in France, un savoir-faire à faire valoir
Made in France, un savoir-faire à faire valoir
Avril 2021
N° 771
Le Portugal, une mosaïque de saveurs
Le Portugal, une mosaïque de saveurs
Mars 2021
N° 770
Brexit, les dessous du deal
Brexit, les dessous du deal
Février 2021
N° 768-769
Label Rouge : La valeur sûre
Label Rouge : La valeur sûre
Décembre 2020 - Janvier 2021