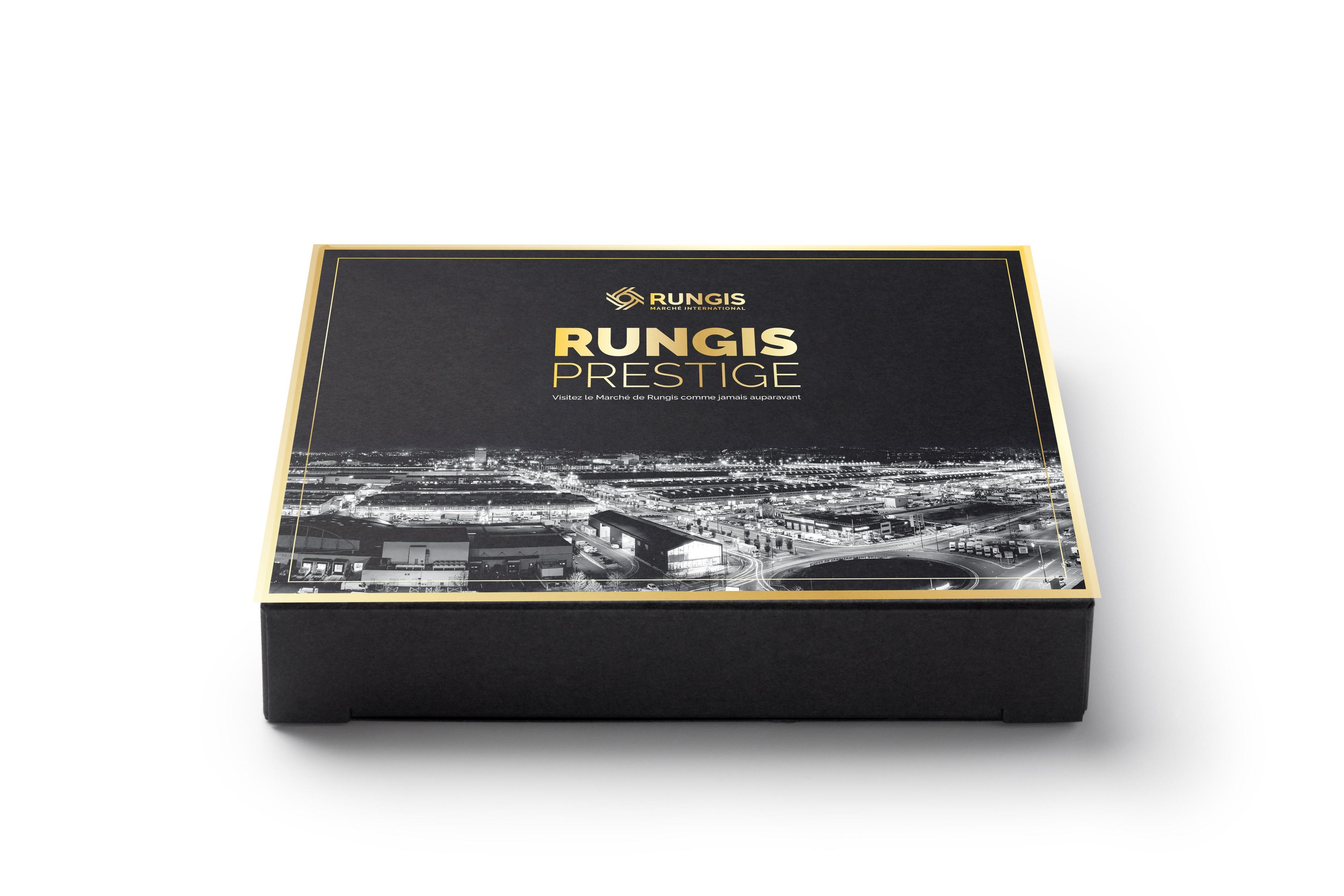Actualités
Découvrez toutes les dernières actus du Marché International de Rungis !
GENERAL
Port obligatoire de la carte Rungis
Port obligatoire de la carte Rungis
06.01.2025
GENERAL
Une nouvelle ligne Express reliant Corbeil-Essonnes au Marché International de Rungis
Une nouvelle ligne Express reliant Corbeil-Essonnes au Marché International de Rungis
26.12.2024
GENERAL
Le Marché de Rungis vous souhaite une excellente année 2025 ! 🎊✨
Le Marché de Rungis vous souhaite une excellente année 2025 ! 🎊✨
20.12.2024
GENERAL
Le Marché de Rungis inaugure une place Auguste Escoffier
Le Marché de Rungis inaugure une place Auguste Escoffier
18.12.2024
EVENEMENT
Un trophée des chefs pour Noël
Un trophée des chefs pour Noël
17.12.2024
RSE
Le Marché de Rungis soutient l'innovation pour l'alimentation durable
Le Marché de Rungis soutient l'innovation pour l'alimentation durable
17.12.2024
RSE
Bientôt, près de 300 points de recharge accessibles à tous sur le MIN !
Bientôt, près de 300 points de recharge accessibles à tous sur le MIN !
12.11.2024
GENERAL
Une agence France Travail sur le Marché
Une agence France Travail sur le Marché
24.09.2024
GENERAL
La Semmaris adopte une raison d'être
La Semmaris adopte une raison d'être
24.09.2024
GENERAL
Le Carreau des producteurs fête ses 20 ans
Le Carreau des producteurs fête ses 20 ans
24.09.2024
GENERAL
La Semmaris a sorti son rapport annuel 2023
La Semmaris a sorti son rapport annuel 2023
17.06.2024
GENERAL
La Semmaris renforce sa capacite de verbalisation sur le Marché
La Semmaris renforce sa capacite de verbalisation sur le Marché
17.06.2024
RSE
Un partenariat d'écologie industrielle avec l'aéroport d'Orly
Un partenariat d'écologie industrielle avec l'aéroport d'Orly
03.05.2024
GENERAL
La SEMMARIS améliore son index d'égalité professionnelle
La SEMMARIS améliore son index d'égalité professionnelle
06.03.2024
GENERAL
Le Macaron 2024 est disponible à Rungis Acheteurs !
Le Macaron 2024 est disponible à Rungis Acheteurs !
06.03.2024
VIDEO
Le coffret RUNGIS PRESTIGE
Le coffret RUNGIS PRESTIGE
17.01.2024
INNOVATION
La carte acheteur maintenant disponible sur mobile
La carte acheteur maintenant disponible sur mobile
22.11.2023
VIDEO
Rungis Groupement Employeurs : des processus de recrutement facilités
Rungis Groupement Employeurs : des processus de recrutement facilités
16.11.2023
RUNGIS ACTUALITE
Le Marché de Rungis, partenaire des Papilles d’Or 2024
Le Marché de Rungis, partenaire des Papilles d’Or 2024
13.11.2023
VIDEO
24h en immersion sur le Marché de Rungis
24h en immersion sur le Marché de Rungis
09.06.2023
FORMATION
Rungis Académie : un laboratoire de formation innovant
Rungis Académie : un laboratoire de formation innovant
09.06.2023
FORMATION
Un compte acheteur pour les apprentis
Un compte acheteur pour les apprentis
09.06.2023