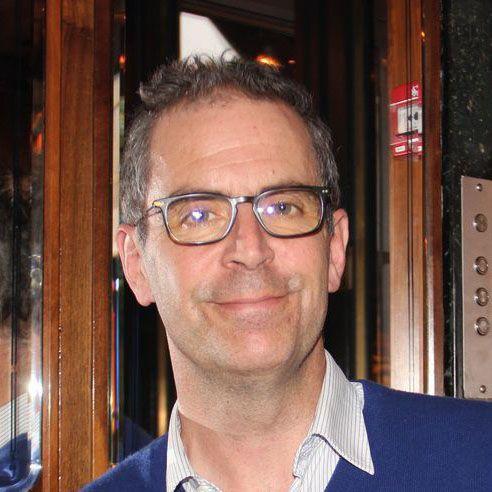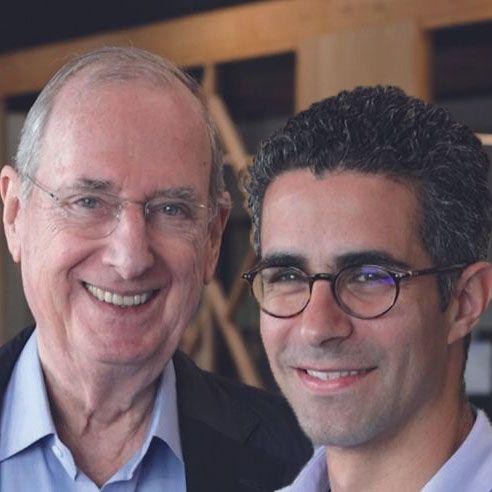Grossistes en produits de la mer
Véritable emblème du commerce de marée français, le bâtiment A4 du Marché de Rungis est le fief de nos grossistes en produits de la mer. Crustacés, coquillages et poissons en tout genre vous attendent sur leurs étals, avec de nombreuses possibilités de découpe, de filetage et de livraison des produits proposées par les opérateurs du Marché.
Grossistes en produits de la mer
Notre sélection en produits de la mer
Nous avons sélectionné pour vous des fournisseurs qui proposent les produits plus recherchés.
Crustacé
Grossistes en crustacé
Grossistes en crustacé
Coquillage
Grossistes en huitres
Grossistes en huitres
Poisson
Grossistes en poisson bleu
Grossistes en poisson bleu
Poisson
Grossistes en traiteur de la mer
Grossistes en traiteur de la mer
Poisson
Grossistes en poisson de mer blanc
Grossistes en poisson de mer blanc
Poisson
Grossistes en poisson surgelé
Grossistes en poisson surgelé
Besoin d'une version papier de l'annuaire ?
Chaque année, nous éditions le carnet d'adresses du Marché de Rungis qui vous permet d'identifier les entreprises en capacité de vous fournir les produits et services recherchés. Chaque entreprise de Rungis y présente ses spécialités et ses coordonnées.
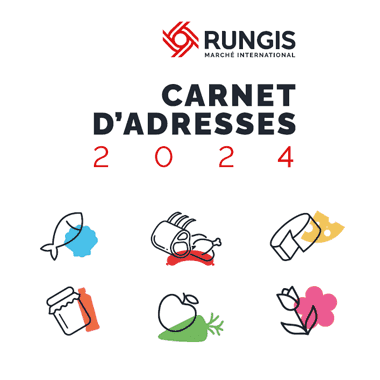
Vous voulez acheter à Rungis ? Nous répondons à vos questions
Profitez d’un code de bienvenue NEW2025
Saisissez ce code promo lors de la création de votre carte d’acheteur
afin de bénéficier de 3 entrées offertes pour 10 achetées !
Portraits de grossistes
Rungis rassemble des grossistes passionnés à votre service pour vous conseiller les meilleurs produits.
06.04.2023
Brigitte Delanchy
Brigitte Delanchy
Brigitte Delanchy
Transports
06.04.2023
Pierre Levy
Pierre Levy
Califrais
Marché
06.04.2023
Estelle & Stanislas Henriot
Estelle & Stanislas Henriot
Dynamis
Fruits & Légumes
06.04.2023
Vincent Soler & Jean-Luc Maury
Vincent Soler & Jean-Luc Maury
Capexo
Fruits & Légumes
11.04.2023
Eric Fontaine
Eric Fontaine
Fruidor
Fruits & Légumes
06.04.2023
Georges Helfer & Olivier Fakhri
Georges Helfer & Olivier Fakhri
Georges Helfer
Fruits & Légumes
06.04.2023
Véronique Gillardeau Aerts
Véronique Gillardeau Aerts
Gillardeau
Marée
11.04.2023
Bertrand Moulins
Bertrand Moulins
Métro FRANCE
Vente de gros
06.04.2023
Michel Charraire
Michel Charraire
Michel Charraire
Fruits & Légumes
Besoin d'un devis ?
Envoyez une demande de devis à l’ensemble des grossistes du marché pour un ou plusieurs produits que vous cherchez à acheter.

Besoin du cours des produits ?
Consultez le cours des principaux produits vendus sur le Marché en partenariat avec le RNM.

Découvrez nos grossistes
Annuaire des grossistes
Fruits et légumes de saison, produits carnés de grande qualité, crustacés fraîchement pêchés et bien d’autres marchandises vous attendent au Marché International de Rungis.

Grossistes Horticulture & Décoration
Retrouvez les différents produits carnés du Marché, dont la variété et la qualité font la réputation de Rungis.